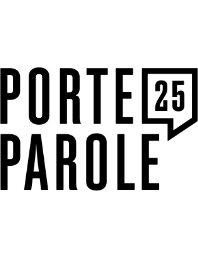Introduction d’Alex Ivanovici
À l’automne 2023, en amont des représentations de Projet Polytechnique au Théâtre du Nouveau Monde, j’ai invité des personnes ciblées à venir voir la pièce et à écrire une réflexion un peu plus formelle. Je n’ai pas donné de consigne, mais l’idée était de donner vie aux échanges sur les enjeux que la pièce soulève, après la relativement courte durée des représentations.
On a approché Pascale Devette, professeur à Université de Montréal en science politique, pour avoir la réflexion d’une femme qui suit la question de la violence faites aux femmes et du féminicide du 6 décembre 1989 depuis plusieurs années. Ayant déjà pris parole sur la place publique et ayant grandi avec un grand oncle qui était professeur dans la classe ou le carnage a commencé, la richesse de la réflexion de madame Devette la rendait incontournable. Elle a accepté.
Projet Polytechnique propose dans un esprit d’ouverture et de sensibilité de creuser la tuerie antiféministe depuis plusieurs angles : l’historique de son déroulement, la question du contrôle des armes à feu, le phénomène des Incels, les féminicides, les tueries de masse. Devant une polarisation accrue de la société, exacerbée par cet effet de bulle dans lequel les médias sociaux enferment nos perceptions, Projet Polytechnique tente une conversation citoyenne. On demande, notamment, s’il est possible de pardonner et de panser nos blessures collectives. La pièce laisse entendre que le tueur d’avant 17h10 pourrait possiblement être pardonné, mais jamais celui d’après, pas celui qui est passé aux actes. Or, qu’en est-il de ceux qui actuellement se radicalisent ? Une des idées soulignées par Projet Polytechnique serait de désamorcer le processus de radicalisation menant à la violence en prenant au sérieux la souffrance masculine. Parmi les pistes explorées, le pardon apparaîtrait comme un vecteur de transformations. Il faut arriver à se parler, à s’écouter sans se juger, de manière responsable. Si une partie de moi a envie de s’accrocher à cette idée, aussi belle qu’admirable, elle passe cependant sous silence les conditions mêmes qui rendent possible le pardon. L’heure est-elle en effet au pardon, alors que la discussion sur les féminicides est à peine entamée ?
Pour ma part, je n’ai jamais eu conscience d’un avant Polytechnique. Aucun âge d’or où la tuerie aurait été un effroyable impensable. Au contraire, j’ai grandi avec l’idée que la tuerie a toujours été terriblement possible. Dans ma famille il arrivait qu’on en parle, autour de l’annuel 6 décembre, mais toujours en catimini, à voix basse, comme on aborde un secret honteux, en prenant bien soin de ne pas raviver les souvenirs douloureux de mon oncle. C’était dans sa classe que le tueur est entré en hurlant « j’haïs les féministes ». Ce n’est que 30 ans plus tard que mon oncle brisera le silence pour revenir sur sa douleur : « Il a tué mes filles », finit par souffler celui qui a également perdu son fils unique de la fibrose kystique.
Il n’y a donc jamais eu d’avant Polytechnique dans mon imaginaire de petite fille, et l’évènement m’a toujours semblé nébuleux, entouré de brouillard, noyé dans le silence ou dilué dans des explications consolatrices. C’était une tragédie, disait-on, dans un registre qui reprenait le vocabulaire des diagnostics médicaux. Comme s’il était dans la nature des choses que certaines femmes meurent du cancer du sein, tandis que d’autres périssent assassinées. Une tragédie causée par « un loup solitaire », un « tireur fou », un « malade », bref, une erreur statistique, une donnée improbable qui ne devrait jamais se reproduire.
Les féminicides quotidiens et les tueries répétées ont tristement montré le contraire. Pour reprendre la comparaison de Catherine Ethier, le loup solitaire commence à ressembler à un banal chat de ruelle. Ici on ne dit pas que chaque homme est tueur potentiel. On dit qu’il faut arrêter de feindre la surprise consternée, comme si le meurtre d’une femme était chose surprenante, alors qu’il est intégré dans un ensemble de pratiques, de rapport de pouvoir et d’omissions qui le rendent possible. La tuerie antiféministe de Polytechnique déploie une grammaire complexe, un continuum de violence nourri par de multiples racines patriarcales. Chercher à dépeindre les tueurs comme des monstres, c’est contribuer à camoufler le continuum de la violence qui s’exerce sur les femmes. Les agressions sexuelles, les violences, les menaces, les humiliations, les préjugés, la volonté de contrôle, à chaque fois, contribuent à ce sentiment sous-cutané d’être une proie simplement parce qu’on est une femme. Il faut fonctionner malgré cette peur subtile, envahissante, dissonante, dirigée vers un ennemi invisible aux multiples visages. Une peur éprouvée pour soi-même, comme conscience d’une précarité existentielle inhérente à notre genre féminin, sentiment de peur qui, dans mon cas, est décuplée depuis que je suis devenue maman d’une petite fille. Mais la peur peut créer des lionnes.
Ce qui ne veut pas dire que tous les hommes sont des prédateurs. Le degré de violence performée par les hommes n’est pas du tout monolithique : certains hommes refusent cette violence, alors que d’autres en usent ; les uns la combattent pendant que les autres s’y accrochent ; il y en a qui tentent d’observer la violence avec lucidité et attention, qui font l’effort de la destituer et de refuser leur privilège de genre – même cela peut être souffrant -, tandis que d’autres camouflent la violence par des idéologies de toutes sortes, passant de l’idéologie de la fusion amoureuse, à l’idéologie de la souffrance masculine causée par les féministes, jusqu’à l’idéologie d’une nature essentielle des genres. Entre ces pôles s’incarne tout un spectre de possibilités.
Dans son livre Se défendre. Une philosophie de la violence, Elsa Dorlin réfléchit aux conséquences subjectives inhérentes à ce sentiment de danger. Il y a, en effet, des existences qui traînent une crispation musculaire derrière une façade de normalité. Terrée au fond de son identité, une part infime, mais intime de soi sait bien qu’elle fait partie de la catégorie des proies. Évidemment, le degré de danger auquel font face les proies parce que femmes diffère – parfois radicalement – selon leurs situations sociales. Mais arrêtons-nous pour l’instant sur ce qui les lie toutes, ce degré zéro de la peur au féminin. Cette peur banale, quotidienne et ordinaire qui nous a appris, depuis toutes petites, que c’est dangereux de se promener seule le soir. Dans la rue, il faut nier ce cœur qui palpite plus vite, s’accrocher aux regards bienveillants des passants et des passantes pour se rassurer, ou, encore, accélérer la cadence en fixant les reflets des vitres pour jauger la distance qui nous sépare de celui qui marche derrière nous.
Dans les multiples sphères de nos vies, nous avons appris qu’il faut vouloir plaire, mais ne pas trop vouloir non plus, à moins de chercher le trouble ; nous avons appris à nous affirmer, tout en sachant concilier et reculer aux premiers signes de danger. Nous avons appris à porter attention à l’autre, à en prendre soin, à intégrer cette sensibilité au cœur de notre conception de nous-même. Faire du bien à l’autre, surtout masculin, nous fait du bien. À la fois par bienveillance, par concordance de genre et par affection, nous portons attention à autrui. À la fois, aussi, parce que nous ne savons pas ce qu’autrui pourrait nous faire. Nous avons compris ce qu’une petite inattention peut coûter en termes de reproche, de conséquence, de punition. Il vaut mieux rester vigilante. Funambule silencieuse, notre intégrité n’est jamais pleinement assurée. Ce point où tout basculerait reste une constante à surveiller.
Cette peur ordinaire est exacerbée à chaque nouveau féminicide. Une peur diffuse, atmosphérique, muette, sur laquelle on s’arrête peu, qu’on traîne avec soi, un poids qu’on ne sent plus, sauf parfois lorsque la carapace fend. Car la peur n’est pas seulement une affaire privée, elle contamine de différentes manières les membres du groupe social visé par la violence. Quand une femme meurt, c’est toutes les femmes qui ont peur.
Les tactiques pour persévérer et fonctionner dans ce tabou généralisé entourant la peur sont multiples. Comme femme, il faut bien souvent déréaliser sa propre expérience, rentrer la peur en soi-même, l’enfouir au fond de ses cauchemars, la ridiculiser à ses propres yeux. Se traiter d’hypersensible, de parano, d’anxieuse, faire du yoga, apprendre à respirer, commencer les arts martiaux, avoir du poivre de Cayenne dans sa sacoche, assurer une charge mentale toujours plus vigilante. Nier le fait que nous sommes des proies, tout en trouvant des dispositifs pour se protéger.
Dans l’imaginaire social, on a encore l’impression que les femmes assassinées par leur conjoint étaient des victimes passives. C’est tout le contraire, les meurtres ont habituellement lieu suite à la séparation, au moment où ces femmes signalent leur refus de la domination. Au moment où elles habitent leur puissance d’agir, résistent à l’oppression et cessent d’être des proies. Elles répondent au péril de leurs vies.
Cela fait si peu de temps, à peine depuis 2018, qu’on commence collectivement à utiliser le terme féminicide. Qu’un mot désigne enfin cette réalité pourtant millénaire. Nous n’avons pas du tout pris la mesure de ce que féminicide veut dire ni de ce que la peur fait à toutes les femmes.
Si les féminicides sont enfin nommés, ce n’est que la pointe de l’iceberg qui émerge dans l’espace médiatique et politique. Si peu est dit sur ces femmes qui vivent une vie dans des conditions invivables. Qui n’ont pas encore été assassinées ou, enfin, pas tout de suite. Elles ne le seront peut-être qu’insidieusement, d’une mort lente et quotidienne, de cette violence qui sans tout à fait annihiler, empêche de vivre. L’ampleur de la domination patriarcale est encore trop souvent silenciée par une vision comptable des vies humaines (combien de femmes sont tuées ?), par une invisibilisation du continuum de la violence, par une dilution de toutes les formes de souffrance (on peut penser ici à la souffrance des masculinistes) dans un grand tout, comme si ces souffrances s’équivalaient.
Le coût d’une place en maison d’hébergement est l’exemple le plus évident : à combien estime-t-on la dignité humaine ? À ma connaissance, je n’ai jamais entendu un.e politicien.ne demander pardon pour son manque d’attention à l’égard de la violence envers les femmes. Certes, leurs visages empathiques et indignés sont bien exposés, mais cette compassion à distance n’appelle pas un sentiment de responsabilité. Nous ne sommes pas spectateurs ou spectatrices de la violence. Ce n’est pas un film que nous regardons, nous y jouons. Nous sommes engagé.e.s dans la violence. Dans nos luttes pour la voir, la nommer, la contrer comme dans nos dénis et nos lâchetés, nos petites lâchetés, qui la reconduisent.
Reste que le pardon est peut-être l’acte politique le plus puissant. Pardonner, rappelle Hannah Arendt dans Condition de l’homme moderne, est la seule faculté qui permet de perdurer ensemble, de continuer à faire communauté malgré l’irréversibilité de nos erreurs collectives. Le pardon est fondamentalement quelque chose qui se déploie à plusieurs : on ne peut se pardonner soi-même, il faut qu’une autre personne nous l’octroie. Suite à l’expression du repentir et de la volonté d’engager un changement, le don du pardon véhiculé par autrui libère le fautif de ce qui a été fait. La personne ayant commis l’acte est alors libre de tendre vers un nouveau départ. L’acte reste irréparable, ce qui a été fait ne peut être défait, mais la personne est émancipée de ce poids. Elle est séparée de son acte, elle se révèle être plus que cet acte. Dès lors, elle peut réintégrer le monde commun. Or, pour que la puissance du pardon soit en mesure d’émerger, il faut laisser le travail du temps faire son œuvre. Il faut, nous dit Arendt, laisser le temps apaiser l’épouvante que provoque l’évènement, afin que s’estompe la terreur devant ce qui a été commis et que soit pleuré ce qui ne pourra être réparé.
J’ai vu la pièce Projet Polytechnique en décembre 2023. Depuis, seulement pour l’année 2024, on compte 24 femmes assassinées au Québec. Parce qu’elles étaient des femmes. Et ce n’est que la pointe de l’iceberg de la violence, celle qu’on arrive désormais à nommer sous le terme de féminicide. Je ne sais pas combien de femme vivent des vies invivables et cherchent à reprendre leur souffle malgré une mort lente et quotidienne. L’effroi suscité par la tuerie antiféministe de Polytechnique est loin d’être estompé. L’horreur sans voix réapparaît à chaque nouvelle femme assassinée. La peur se sédimente au fond de nos corps, immobiles et pourtant prêts à exploser. Polytechnique ce n’est pas une histoire ancienne qu’on traîne, une vieille affaire classée, c’est une peur actuelle pour laquelle nous commençons à peine à trouver les mots. Car il règne encore des silences qui assourdissent.
Est-ce qu’on peut pardonner, quand on a encore peur ?

Pascale Devette
Pascale Devette est professeure adjointe à l’Université de Montréal au département de science politique. Elle a fait sa thèse à l’Université d’Ottawa (théorie politique) et à l’Université Paris-Diderot (Philosophie politique) sur les pensées d’Albert Camus, de Simone Weil et d’Hannah Arendt. Ses recherches portent sur la question du tragique, de la démesure, de la violence, des récits des rescapé.e.s d’expériences limites et de la philosophie du travail. Ses travaux actuels s’inscrivent dans le champ de la pensée critique et féministe, en interrogeant les notions de vulnérabilité, de précarité, de genre et de matérialité.